Soi-même
« Comment faire pour se redéfinir avant d’avoir eu la possibilité de se définir une première fois? » –Katie
Souvent, quand notre monde nous paraît tout chamboulé, nous sommes confrontés à des questions existentielles. Qui suis-je maintenant? Qui est-ce que je veux être? Ici, nous décrirons la façon de rester fidèle à soi-même et de puiser dans nos forces intérieures pour nous adapter à l’évolution de notre situation.
Chaque fois qu’une personne me demande ce qui se passe ou ce qui m’est arrivé,
le choc et la terreur se lisent sur son visage quand je lui explique ma situation.
Si mon moi d’avant pouvait voir mon moi d’aujourd’hui, je serais curieuse de savoir comment je fais pour endurer tout ça.
Quand je compare ce que j’étais capable de faire avant et ce que je peux faire aujourd’hui, avec toutes mes limitations, sans parler de l’imminence de ma mort, ça en fait beaucoup à absorber. C’est particulièrement difficile au début.
À mon premier diagnostic, j’ai pris consciemment la décision de ne pas laisser le cancer me définir.
J’ai appris à prendre les commandes et à faire en sorte que le cancer soit une partie de moi et non la totalité de moi. Mais maintenant que je suis en phase terminale, c’est différent. J’ai l’impression d’avoir perdu de vue qui je suis, parce qu’à ce stade, le cancer touche tous les aspects de ma vie et a tout changé. Il contrôle ma mobilité, ma sexualité, ma spiritualité, mes relations, mes finances. Quand je rencontre des gens, j’ai tellement de difficulté à répondre aux questions habituelles que je finis par mentir. Je leur raconte le travail que je faisais, ou je réponds : « non, nous n’avons pas encore d’enfants », comme si c’était par choix. Si je ne mens pas, alors la conversation tourne à 100 % autour du cancer.
Je crois que ma relation avec le cancer demeure inhabituelle.
Je compatis quand un membre de ma famille, un ami ou un être cher est emporté par le cancer. Mais ça me met mal à l’aise que des gens disent, par exemple : « Je hais le cancer. » Le cancer ne me semble pas envahissant. Génétiquement, la plupart d’entre nous le portent à la naissance. Il est ancien et plus « humain » que ma maladie. Ça me réconforte de sentir que mon cancer fait partie de moi, tout autant que ma voix, mes yeux ou mes mains. Je vois peut-être la mort avec trop de stoïcisme ou de philosophie. Pour moi, le monde est surpeuplé; si le cancer m’emporte, ça signifie peut-être que ça fait partie de ma mission de laisser de l’espace à une nouvelle personne.
Au début, on m’a dit que dans le cas de mon cancer, l’espérance de vie médiane est de 18 à 24 mois.
Mais ensuite, on m’a dit : « Nous avons tous des patients qui vivent plus longtemps que cela. » Mes chances de survie au-delà de cinq ans sont de 20 % seulement. Vous voyez comme ça diminue : 80 % des femmes atteintes du même cancer que moi ne survivent pas cinq ans. Mais les statistiques ne sont pas des personnes.
Le cancer contrôle ma mort, mais je refuse qu’il contrôle ma vie.
Je ne veux pas qu’il me définisse, mais je ne sais même pas si c’est possible. Le cancer prend toutes les décisions importantes pour nous. Il a décidé que nous n’aurions pas d’enfants et que je ne pourrais pas travailler. Il agit sur la qualité de mon sommeil, sur ce que je mange, sur mes activités, sur mes relations avec ma famille. Il a tout changé, à tous les points de vue. Je n’arrive plus à me distinguer de mon cancer. En toute franchise, je ne sais pas où se situe la frontière entre le cancer et moi.
L’oncologue ne m’a jamais donné de statistiques sur l’espérance de vie.
En gros, c’est moi qui ai consulté les statistiques types. Là encore, ce sont des données américaines. Il y a très peu d’études canadiennes. J’aime à savoir à quoi je suis confrontée. Je comprends que les statistiques concernent le passé. Elles ne prédisent pas mon avenir, mais elles représentent ce que des gens ont vécu. Je peux donc me faire une idée sur des questions comme : « Est-il plus probable qu’il me reste quelques années ou quelques mois? » D’après les données que j’ai trouvées, l’espérance de vie moyenne des personnes atteintes de cancer du sein de stade IV est de 33 mois. Je pense que ça a du sens, parce que j’ai eu des amies qui n’ont vécu qu’un mois ou deux après leur diagnostic et d’autres qui étaient toujours vivantes après sept ans. J’ai vu les deux côtés de la médaille. Ces idées-là m’habitent quand je pense à mon cas.
Mon médecin a eu du mal à trouver les mots pour me dire que tous mes traitements de chimio avaient échoué.
Il essayait de dire : « Nous sommes pris entre le marteau et l’enclume », mais il a buté sur le mot « marteau », visiblement troublé. Il essayait désespérément de se rappeler l’expression… J’ai achevé la phrase pour lui, j’ai essayé de lui donner de la force par mon langage corporel, sans oser regarder ma mère qui était assise avec moi. Je savais ce que ça voulait dire; d’une certaine manière, j’étais prête. Ça s’en venait depuis un bon bout de temps, et ça m’a aidée à garder mon calme à ce moment-là… mais environ deux minutes plus tard, la réalité m’a rattrapée. Tout à coup, je m’agrippais à la moindre idée qui me permettrait de survivre; le moment d’après, je demandais à mon équipe ce qu’on ressent quand on meurt. C’était comme une boîte de Pandore, remplie de questions sans réponse.
Il y a bien des choses liées au cancer qui ne sont pas des questions de vie ou de mort, mais qui ont un effet significatif.
Comme j’ai le syndrome de Horner, un de mes ganglions lymphatiques s’appuie sur le nerf qui contrôle ma paupière gauche. Ma paupière pendouille un peu et ne se dilate pas normalement. C’est mon visage! Les gens ne le remarquent pas si je n’en parle pas, mais moi, je m’en aperçois.
Mes poils de nez me manquent vraiment. Maintenant, j’ai toujours le nez qui coule.
Les gens ne se rendent pas compte que quand on perd ses cheveux, on perd aussi tous ses poils. C’est pour ça qu’on a le nez qui coule jour et nuit.
Ma chirurgie reconstructive a été importante pour moi. Elle me donnait une certaine impression de normalité quand je me regardais dans le miroir.
Je voulais avoir juste un petit peu de normalité et de contrôle dans ma vie, c’est tout. Depuis que la reconstruction a échoué, mon mari continue à me soutenir et à dire que c’est à moi de décider [au sujet d’une autre chirurgie reconstructive]. Moi, je veux retrouver mon apparence d’avant. Il s’agit aussi de la capacité de faire de petites choses pourtant essentielles, comme porter une chemise sans avoir un côté bombé et l’autre plat, ce qui étire et use mes vêtements d’un côté, mais pas de l’autre.
Quand je me regarde, je vois les 50 livres que j’ai prises à cause du traitement et de l’inactivité occasionnée par la maladie, les fractures et l’épuisement général.
Je vois des poils apparaître sur mon visage parce que je suis en ménopause à la fin de la vingtaine. Je vois mes dents crochies par l’action du cancer sur ma mâchoire. Je vois des cicatrices. Je vois un visage entre deux âges alors que je n’ai que 33 ans. Je m’aide d’une canne pour marcher. Je vois les éraflures causées par les médicaments qui éclaircissent mon sang...
Sur le plan de l’apparence, je me démarquais beaucoup par ma chevelure.
J’ai toujours eu les cheveux longs. Ils me descendaient jusqu’à la ceinture la première fois que je les ai perdus et jusqu’à la poitrine la deuxième fois. Ce serait formidable d’avoir une certaine normalité de ce côté-là aussi. Maintenant, je porte des perruques idiotes, bleu électrique, rose bonbon… Je les ai plutôt pour m’amuser; je peux en porter une si ça me chante. On s’habitue à une chose évidente comme la chevelure et, tout à coup, elle disparaît.
Ma voix n’est plus ma voix. Ça m’affecte beaucoup.
Ma voix! C’est ma voix! Voyons donc... ça aussi!?! J’ai souvent l’impression de n’avoir aucun contrôle. Mon identité dépend tellement de ce genre de choses : la façon dont je m’entends, ma capacité à contrôler les modulations de ma voix, mon apparence dans le miroir.
Quand une personne me croise dans la rue, elle n’a aucunement l’idée que j’ai le cancer, parce que je ne ressemble pas du tout à l’image du patient cancéreux véhiculée par la culture pop.
J’ai les cheveux courts et clairsemés (je ne suis pas chauve), les sourcils forts et épais, et un visage bouffi plutôt que décharné. Je suis en deuil de mon corps. Pas seulement de sa capacité à exister sans douleur ou sans cancer, mais de cet aspect soi-disant « superficiel », l’apparence. Plus je pense à ce qu’on dit, que l’apparence, c’est « seulement superficiel » (et c’est tout à fait vrai), plus je suis choquée de voir à quel point les gens qui m’entourent semblent la valoriser. Et pourtant, même si, quand je sors, les gens me dévisagent et, parfois, semblent inquiets en voyant mes cheveux clairsemés, mes énormes bandages et ma peau jaunâtre, je me suis rendu compte que quand je souris et que je ris, les gens sourient et rient avec moi comme ils l’ont toujours fait. Je suppose que ce n’est pas tout blanc ou tout noir. J’ai appris qu’il n’y a rien de mal à avoir la nostalgie de ce que j’ai perdu, et en même temps, je découvre toute la puissance et la vérité de la beauté intérieure.
J’ai vu des tas d’AJA [adolescents et jeunes adultes] cancéreux qui sont en colère, et il y a de quoi.
Beaucoup de mes amis sont en colère à cause de mon diagnostic, mais ce sentiment ne m’atteint pas très souvent. Je pense que pour moi, la colère n’est qu’un gaspillage d’émotions. J’aurais beau me fâcher, ça ne changera rien à mon diagnostic. C’est une chose qui m’arrive, rien d’autre. Je ressens beaucoup d’émotions, mais la colère n’en fait pas partie. Je sens que la colère m’épuiserait encore plus, et c’est déjà très épuisant d’avoir un cancer. Si la colère avait un exutoire, ce serait peut-être différent. Mais il n’y a personne à blâmer, la colère n’a pas de cible précise. Personne ne peut être tenu responsable. Le cancer ne fait pas de discrimination. Il est tellement aléatoire! Il est arrivé, c’est tout.
Ce que nous ressentons, mon mari et moi, c’est beaucoup de tristesse.
Nous nous sortons d’à peu près tout en riant… probablement pour ne pas pleurer. Mais pour nous, il vaut mieux en rire que de se fâcher et de se disputer. Ce n’est pas facile, mais c’est une décision que nous avons prise et un choix que nous avons fait consciemment.
Si mon moi d’avant pouvait voir mon moi d’aujourd’hui, je serais curieuse de savoir comment je fais pour supporter tout ça.
Quand je compare ce que j’étais capable de faire avant et ce que je peux faire aujourd’hui, avec toutes mes limitations, sans parler de l’imminence de ma mort, ça en fait beaucoup à absorber. C’est particulièrement difficile au début.
L’anniversaire du jour de mon diagnostic, le 11 mars, est un jour pénible pour moi.
Ça a fait sept ans cette année. Je déteste absolument ce jour-là. C’est une date que personne ne remarque. Je ne reçois pas des tas de messages de gens qui soulignent cet anniversaire-là. Quelques personnes, très peu, sont au courant. J’ai juste hâte que la journée finisse. Vers la fin de 2017, j’ai compris que je ne voulais plus affronter ce jour-là comme je le faisais depuis six ans. J’ai voulu faire autre chose. Je parle toujours de toute la chance que j’ai eue au cours de ma vie. J’ai tellement de richesses, malgré le cancer de stade IV. J’ai vraiment une vie formidable, je suis bénie. Alors, je me suis dit : « Je vais faire 100 jours de gratitude. » J’ai compté à rebours à partir du 11 mars : le 2 décembre, c’est 100 jours avant le 11 mars. J’ai décidé de créer une chaîne YouTube et de produire chaque jour une vidéo sur un sujet différent qui m’inspire de la reconnaissance. Je savais que ce ne serait pas difficile : je pourrais facilement trouver 100 sujets différents. Chaque jour, j’ai tourné une vidéo de 5 à 10 minutes sur une chose qui suscite ma gratitude. Ma chaîne a pris un peu d’ampleur, quelques journalistes l’ont découverte et ont écrit des articles sur le sujet. J’avais plusieurs abonnés. Au fil du temps, je me suis dit : « Mais c’est que j’y prends goût! » Puis le 11 mars est arrivé, et dans ma 100e vidéo, j’ai parlé de mon mari. Là encore, ça a pris beaucoup d’ampleur, et j’ai eu beaucoup plus de facilité à vivre le 11 mars. Ça a tout à fait marché. Ça a produit le résultat voulu. Ce que je n’avais pas prévu, c’était que je constaterais l’immensité de ma gratitude envers la vie, et je me suis VRAIMENT rendu compte que la question n’est pas de savoir combien de temps il nous reste, mais bien ce que nous allons en faire. La qualité avant la quantité. J’ai pris une grande respiration, et je me suis dit : « Ça alors, ce projet était bien plus gros que je l’aurais pensé. » Il a eu des retombées énormes. Et là, j’ai appris que le traitement en essais cliniques qui avait eu des effets stables pendant deux ans et demi avait cessé de fonctionner. J’ai participé à un autre essai. Mon cancer a progressé encore plus. Maintenant, je suis de nouveau en chimio. Ce que j’ignorais, c’est que le 12 mars, mes amis et ma famille se sont regroupés pour commencer les 100 jours de Katie. Ils s’étaient contactés à mon insu. Il y a eu 100 vidéos différentes sur la gratitude des gens envers moi et envers leur vie. C’est devenu tellement contagieux que chaque jour, je recevais une nouvelle vidéo d’une personne qui compte dans ma vie. J’en suis restée baba! Puis, au milieu de tout ça, mon 34e anniversaire approche. Les anniversaires, c’est une énorme affaire pour moi. Je n’étais pas certaine de vivre mon 32e anniversaire, et nous en sommes au 34e. Alors j’ai décidé de faire un autre cycle de 100 jours qui se terminera le jour de mon anniversaire. Cette fois, il s’agit de 100 bonnes actions en vrac. Tant de monde a fait tant de choses pour moi... Je savais que je retournais en chimio et je voulais me rappeler tous les jours les gens formidables qui enrichissent ma vie. Et je voulais que ça fasse partie de mon héritage. Désormais, quiconque se sent démuni face à un ami cancéreux pourra consulter 100 vidéos et 100 actions que des gens ont faites pour moi et pourra faire la même chose pour son ami. J’en suis au 88e jour des 100 choses que des gens ont faites pour moi. Je pourrais en citer 1 000.
Je pense que ma meilleure stratégie d’adaptation, c’est d’essayer de me libérer de toutes les horreurs qu’on sait si bien se raconter à soi-même.
La théorie cognitivo-comportementale m’a vraiment aidée. Quand je m’en prends durement à moi-même et que je me chante des bêtises, je m’imagine que je téléphone à une de mes amies. Si elle me disait comment elle se sent et ce qu’elle vit, je ne l’enverrais pas promener. Je ne lui dirais pas : « Tu devrais marcher davantage, et on s’en fout si tu as une double fracture du pelvis », ni « Fais-toi donc arranger les dents » ou toutes les horreurs que je peux me dire. Je lui dirais : « Tu as un cancer de stade IV. Ton corps fait tout ce qui est en son pouvoir pour se guérir, pour supporter les traitements, pour venir à bout du cancer. Aujourd’hui, tu t’es réveillée et tu es sortie du lit. Ça, c’est une victoire. » Je m’imagine qu’une des nombreuses personnes qui comptent dans ma vie me ramène sur terre en me rappelant que ma vie est dingue et que mes désagréments physiques sont un effet secondaire de la période merdique que je traverse.
Les promenades, surtout les longues errances, ça m’aide vraiment.
Je faisais de la course à pied, mais pour le moment, la douleur dans mes os m’en empêche. Mais je peux marcher. En marchant, je vis encore l’expérience de voir la ville à un rythme humain. En marchant, on vit un lent changement de décor, et notre relation avec ce qui est là évolue. Ça a une importance inimaginable pour moi.
Un de mes principaux moyens d’adaptation est de consulter un psychiatre.
Pendant quelques années, j’en ai même vu deux, parce que ma psychiatre initiale n’était pas en mesure de me voir plus qu’une fois par mois. Elle m’a donc trouvé une collègue qui pouvait me voir toutes les semaines. Je consulte en psychiatrie depuis des années. J’ai commencé peu de temps après mon diagnostic de récidive, parce que je voulais parler à quelqu’un d’autre que mon mari. Je lui parle de tout et il est mon principal soutien, mais je ne voulais pas tout lui mettre sur les épaules. Je voulais avoir un espace où je pourrais tout faire sortir, pleurer et parler de mes craintes les plus sombres sans blesser la personne à l’écoute. C’est difficile de ne pas imposer aux membres de sa famille une douleur similaire quand on extériorise sa douleur la plus profonde. D’ailleurs, très peu de gens m’ont vu le faire.
La frontière entre la tragédie et la comédie est souvent mince, alors je passe mes journées à faire des blagues, de mauvaises blagues, toutes sortes de blagues.
Je ris toute seule, avec mes parents, mes amis et mes professionnels de la santé. Dans les moments plus sérieux, j’utilise une technique de méditation qui ne m’a jamais fait défaut. J’expire la « noirceur » et la négativité, et j’inspire une « clarté », de la joie, de l’espoir et de la force. Ça m’aide à assimiler ce qui me stresse et me blesse à ce moment-là, mais en laissant sortir ce qui est mauvais. Ça m’a aussi aidée à puiser dans mes forces et à prendre le temps de manifester de la reconnaissance pour ce que j’ai. Par-dessus tout, l’humour et la méditation me donnent le sentiment de maîtriser la situation.
Comme je suis si souvent seule, nous allons bientôt avoir un chiot!
Je suis emballée. Comme ça, je ne serai pas vraiment seule. Quelqu’un va me suivre d’une pièce à l’autre, ce sera formidable. Les animaux donnent un amour pur qui est très substantiel...
Conseils des fournisseurs de soins de santé
Le soi et l’identité
« Qui suis-je maintenant? » Voilà une question que se posent beaucoup de jeunes adultes atteints d’une maladie grave. La façon d’y répondre dépend de vous, car personne d’autre n’a le droit de définir qui vous êtes. Vous constaterez peut-être une évolution dans votre définition d’autres concepts, par exemple « à quoi ressemble le succès » ou « ce qui a vraiment de la valeur pour moi ». Peut-être que le « succès » se résume à se lever du lit et faire quelque chose de votre journée. Ce qui a de la « valeur » pour vous, ce sont peut-être vos proches et les relations importantes que vous vivez. Après tout ce que vous avez enduré, vous pourriez avoir l’impression d’être une personne différente. Se pourrait-il qu’un événement aussi important ne change rien à votre vie? Votre propre identité a probablement évolué d’une façon ou d’une autre. Il y a peut-être une part de vous qui souhaite que les choses reviennent comme elles étaient. La chirurgie ou les traitements ont peut-être transformé votre corps. C’est difficile de s’ajuster à ces changements. Il y a peut-être une autre part de vous qui aime la personne que vous êtes devenue. Une autre encore se sent perdue dans la confusion au milieu de tout ce processus. Il est tout à fait possible que vous ressentiez toutes ces impressions à des moments variés, si ce n’est pas en même temps!
Vous avez peut-être des problèmes d’estime de soi et d’image corporelle. Quand on est un adolescent ou un jeune adulte atteint d’une maladie grave, on est tellement soumis à la pression de rester positif (de la part des autres et de soi-même) que cela nous paraît mal de se sentir déprimé ou perturbé. Il est tout à fait compréhensible (et prévisible) de connaître des jours moches. Il ne faut pas que tous les jours soient comme ça, mais les humains ne sont pas censés être toujours super-positifs. Essayez de faire preuve de patience et de compassion envers vous-même.
Il y a probablement des portions de votre identité d’avant le diagnostic que vous voulez continuer de porter avec vous. Il y a peut-être aussi d’autres parts de vous-même ou certaines relations ou valeurs que vous voudriez laisser derrière vous. C’est correct. C’est votre choix. C’est aussi une décision très personnelle.
Vous découvrirez peut-être que d’autres vous accolent des étiquettes : « c’est un guerrier », « c’est une battante, une survivante », « c’est un héros », « il est brave », « elle est courageuse ». Si ces étiquettes ont un sens et vous conviennent, c’est parfait, mais il se peut aussi que vous les trouviez inappropriées ou même nuisibles. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse : certains y voient une utilité, certains trouvent d’autres moyens de se décrire. Vous pourriez rejeter toutes les étiquettes, parce que rien ne peut traduire toute la complexité de votre personne.
Il faut du temps pour comprendre qui on est maintenant et qui on veut être. Ce n’est pas un événement ponctuel; le fait de changer et de se développer au fil du temps et des expériences de vie fait partie de notre humanité. Mais le noyau central de votre personne est et sera toujours avec vous





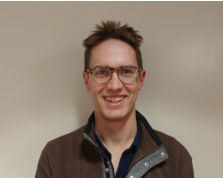
Katie Davidson
J’ai eu mon diagnostic à 26 ans. Comme bien des gens de cet âge-là, j’en étais encore à essayer de comprendre qui j’étais.
D’après les sites Web et les professionnels, quand on reçoit un diagnostic de cancer, il faut « trouver sa nouvelle normalité » ou « se redéfinir ». Je ne peux pas m’empêcher de penser et de dire à quel point c’est dingue de recevoir un diagnostic si jeune. On n’a même pas eu la chance de découvrir qui on est, point final. Comment faire pour se redéfinir avant d’avoir eu la possibilité de se définir une première fois?
Katie Davidson
Je suis à trois décennies de l’âge où la plupart des gens reçoivent un diagnostic, et j’avais huit ans de trop pour être considérée comme un cas pédiatrique.
Les gens n’y comprennent rien : « Mais tu n’es pas censée avoir le cancer! » Ça ne tient pas debout. Ça n’a aucun sens.